Les casques à conduction osseuse
Les casques à conduction osseuse – un outil pertinent en milieu professionnel ?
La conduction osseuse (CO) est une technologie qui consiste à transmettre des vibrations mécaniques directement à travers les os du crâne jusqu’à l’oreille interne, permettant ainsi d’entendre sans obstruer les conduits auditifs. Initialement conçus pour pallier certains handicaps auditifs ou pour des utilisations militaires, les dispositifs utilisant cette technologie connaissent un essor important dans les loisirs (écoute de musique, activités sportives). Récemment, leur usage potentiel en environnement professionnel, notamment industriel, commence à être envisagé. Cependant, leur adoption dans ce contexte requiert une analyse approfondie des avantages et limites associées.
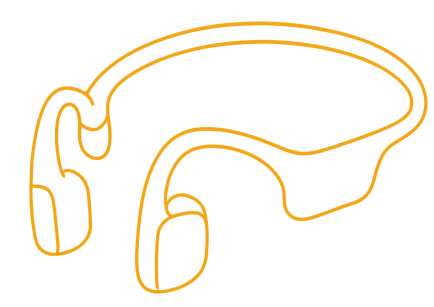
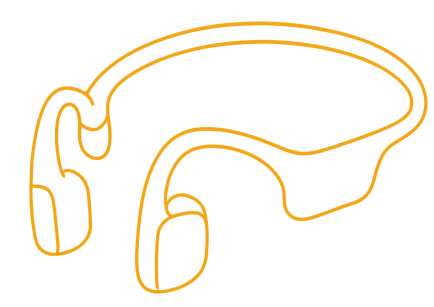
Principe et fonctionnement des casques à conduction osseuse
Contrairement aux écouteurs traditionnels qui utilisent des haut-parleurs transmettant le son via l’air dans le conduit auditif, les casques à conduction osseuse transmettent les sons par vibrations directement à travers les os de la mâchoire et du crâne vers l’oreille interne. Ce mode de transmission présente deux avantages majeurs :
- Il permet à l’utilisateur de maintenir une audition naturelle de son environnement.
- Il peut être utilisé simultanément avec des bouchons d’oreilles tout en maintenant la communication.
Usages et bénéfices potentiels en milieu professionnel
Un point important à noter concerne la qualité audio limitée de ces dispositifs. Les casques à conduction osseuse ne restituent pas efficacement les fréquences graves et aiguës, ce qui les rend peu adaptés à l’écoute musicale de haute-fidélité. L’utilisateur doit se contenter principalement des fréquences médiums, ce qui suffit pour la voix mais limite l’usage à des fonctions de communication ou de guidage sonore, plutôt que de divertissement.
Pour pallier ce manque, certains fabricants ont ajouté de petits haut-parleurs à leurs dispositifs afin de transmettre les fréquences aiguës et graves par l’air. Toutefois, ces sons ne passent donc plus par les os mais par voie aérienne classique, ce qui rend ces dispositifs hybrides ou semi osseux. Ils perdent ainsi en partie les avantages spécifiques de la conduction osseuse, notamment en cas de port de bouchons contre le bruit qui empêcheront cette transmission aérienne.
L’utilisation de casques à conduction osseuse en milieu professionnel pourrait présenter certains avantages spécifiques :
- Amélioration de la sécurité : En permettant une écoute de l’environnement sonore naturel (dans les environnement non bruyant) tout en recevant des communications ou alertes, ces casques pourraient améliorer la sécurité, notamment dans les milieux industriels où les alertes sonores jouent un rôle crucial.
- Maintien de la communication : Ils offrent la possibilité de communiquer efficacement même lorsque l’utilisateur porte des protections auditives passives telles que les bouchons d’oreilles.
Réserves et précautions soulevées par l’INRS
Malgré ces avantages potentiels, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a exprimé des réserves importantes dans son guide récent sur les protections auditives (ED 6510 – 2024). L’INRS souligne notamment :
- Difficulté de mesure de l’exposition sonore : Actuellement, il n’existe pas de méthode fiable et reconnue pour mesurer précisément les niveaux sonores générés par la conduction osseuse. Ainsi, l’exposition réelle au bruit via ces dispositifs reste mal quantifiable.
- Compatibilité limitée avec les protections auditives passives : L’utilisation concomitante de bouchons d’oreilles et de casques à conduction osseuse pourrait altérer le fonctionnement optimal de ces derniers, limitant leur efficacité réelle en situation de travail.


Par conséquent, en l’état actuel des connaissances, l’INRS ne recommande pas ces dispositifs en milieu professionnel à titre principal pour la protection contre le bruit.
Aspects méthodologiques : l’importance des études sur les courbes isosoniques
Pour évaluer précisément les potentialités et limites des casques à conduction osseuse, il est essentiel de mener des études approfondies sur la perception sonore, notamment à travers les courbes isosoniques. Ces courbes comparent la perception de l’intensité sonore selon différents modes de transmission (Air-Air, Air-Os, Os-Os) et permettent ainsi de calibrer les dispositifs de manière précise.
Plusieurs facteurs peuvent faire varier la restitution sonore :
- La santé auditive, l’âge ainsi que les caractéristiques anatomiques.
- Les signaux sonores utilisés : privilégier les bruits étroits pour des résultats pertinents.
- Le positionnement sur le crâne : localisation précise et pression adéquate du dispositif de conduction osseuse.
Recommandations pratiques pour une utilisation en association avec des protections individuelles contre le bruit
Pour la personne en charge de la sécurité des salariés le choix d’équiper ou non ces derniers de casques à conduction osseuse doit être évaluée avec prudence. Voici quelques recommandations pour guider cette réflexion :
- Analyse préalable des besoins réels : déterminer précisément les situations dans lesquelles le maintien de l’audition de l’environnement est essentiel.
- Essais sur le terrain : effectuer des essais pilotes en conditions réelles pour évaluer la pertinence et l’efficacité de ces dispositifs dans le contexte spécifique de l’entreprise.
- Veille normative et scientifique : rester attentif aux avancées techniques et méthodologiques concernant les moyens de mesure des niveaux sonores induits par ces dispositifs.
- Communication interne : sensibiliser et former les salariés à l’utilisation appropriée de ces dispositifs, tout en les informant clairement sur les limites actuelles identifiées par les autorités telles que l’INRS.
Conclusion
Bien que prometteurs, les casques à conduction osseuse nécessitent encore des validations scientifiques et normatives supplémentaires pour être pleinement intégrés en milieu professionnel. L’évolution des méthodes de mesure et la recherche sur les courbes isosoniques permettront certainement de lever ces obstacles dans les années à venir.
Les écouteurs antibruit qui sont utilisés pour le divertissement doivent obligatoirement être certifiés selon la norme EN-352-10. Au cours de la certification le laboratoire d’essai doit contrôler que le niveau sonore émis sous le protecteur ne dépasse pas les 82dB(A), dans le cas contraire le système ne sera pas considéré comme un équipement de protection individuelle (EPI). Aujourd’hui ce contrôle n’est pas possible avec les systèmes ostéophoniques, la sagesse voudrait que l’on s’abstienne de les utiliser. Comment s’assurer qu’un salarié équiper de bouchons contre le bruit ne reçoivent pas en simultané un niveau sonore du système ostéophonique de 90dB(A) ou plus ?
Sources
Patrick, R. N. C. & Letowski, T. R. (2023). Bone Conduction Equal-Loudness: Methodological Issues. ICSV29, International Institute of Acoustics and Vibration.
INRS. (2024). Guide de choix sur les Protections auditives (ED 6510).
Aller plus loin
Consultez l’article sur La conduction osseuse, une limite méconnue des protecteurs auditifs


